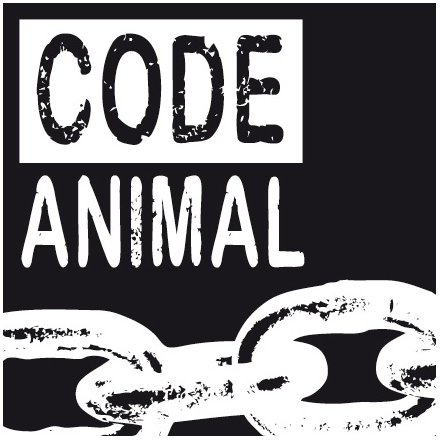Mise à jour
Le 4 mai 2021, la Cour d’appel de New York a accepté d’étudier la demande de libération d’Happy, sur la base de l’interdiction à l’enfermement issue de l’Habeas Corpus. Une première ! La demande avait été déposée le 27 janvier, suite au rejet des demandes de l’association présidée par l’avocat Steven Wise, NonHuman Rights Project (NhRP), « ces problèmes sont au centre philosophique du domaine croissant qu’est le droit animal [1] ».
Le 1er février, La société pour la conservation de la vie sauvage (The Wildlife Conservation Society) s’y oppose.
Le 4 février , cinq théologiens catholiques ont également contribué à cet évènement. Bien que non directement liés à l’affaire judiciaire, ils soumettent des suggestions/opinions au juge afin que celui-ci bénéfice d’un large palette d’informations pour trancher le litige (on parle alors d’Amicus curiae). En effet, ils arguent notamment qu’Happy « est une espèce que Dieu a créée pour prospérer, d’une certaine manière » et n’est en aucun cas « une chose que nous avons le droit d’enfermer, d’utiliser, pour notre divertissement dans un zoo[2]. »
Encore une fois, The Wildlife Conservation Society va s’y opposer.
La NhRP se basera ensuite sur la décision de la Cour constitutionnelle colombienne concernant le cas de Chucho, un ours auquel a personnalité juridique fut accordée en se basant sur l’Habeas Corpus afin de ne plus vivre enfermé dans un zoo et « être relâché dans la réserve dans laquelle il vivait »[3].
Si les juges acceptent la libération d’Happy, ce sera une première aux États-Unis ; ouvrant ainsi d’avantage les débats sur la personnalité juridique de ces autres animaux, et de la supériorité de leur droit à la liberté à notre volonté de les asservir.
[1] NHRP, https://www.nonhumanrights.org/client-happy/
[2] Ibid
[3] https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/colombie-la-justice-libere-l-ours-chucho-enferme-dans-un-zoo_115208

Photo Credit : Pixabay
Des êtres sans parole ni intention, assimilables à des machines : telle était la thèse avancée au XVIIIe siècle par René Descartes pour définir les animaux. L’animal est aujourd’hui défini en droit français à l’article L214-1 du Code rural et de la pêche maritime comme « un être sensible qui doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. »
Malgré le chemin parcouru et la reconnaissance de l’animal non plus comme un bien meuble, mais comme un être vivant doué de sensibilité, les conditions de détention restent en réalité bien souvent incompatibles avec l’expression des besoins biologiques propres à l’espèce.
L’exemple le plus parlant est sans nul doute celui de l’ours polaire, véritable symbole de l’arnaque à la conservation dans le discours des zoos. Conservation et éducation du public sont en effet les arguments majeurs que les parcs zoologiques mettent en avant pour justifier la captivité. Ainsi, présenter des ours polaires captifs serait un moyen d’alerter les populations sur les dangers que représente le réchauffement climatique…
Le cas des éléphants est lui aussi explicite, car sous couvert d’éducation, on met à disposition du public des individus captifs sur des espaces réduits, alors que le bien-être de ce grand mammifère passe par la satisfaction de besoins sociaux et environnementaux si particuliers.

Photo crédit : Pixabay
Steven Wise, avocat en droit animal renommé et fondateur du Nonhuman Rights Projet, a récemment plaidé en faveur d’une victime de l’enfermement et de l’isolement, utilisée pour le divertissement. Malheureusement, ses arguments n’ont pas convaincu la juge Alison Tuitt de la Cour Suprême du Comté de New York, la raison principale étant que la défendue est un pachyderme.
C’est l’histoire de Happy, éléphante d’Asie, capturée en 1977 pour être vendue à un cirque en Californie.
Elle a ensuite été transféré au zoo du Bronx à New York.
Après la mort de Grumpy, compagnon d’infortune capturé en même temps qu’elle et décédé en 2002 de ses blessures à la suite d’une violente confrontation avec les deux autres éléphants du parc, Happy a ensuite été placée en présence d’un jeune mâle, Sammie, mais celui-ci sera euthanasié peu de temps après à cause des symptômes d’une maladie incurable.
Une cohabitation avec d’autres congénères qui s’est révélée trop houleuse a finalement conduit à son isolement total en 2006.
C’est ainsi qu’Happy, âgée de 50 ans environ, a pu recevoir le triste surnom de « l’éléphant le plus solitaire » par le New York Times

Photo crédit : Pixabay
En quatre ans, trois éléphants sont décédés au zoo du Bronx, conférant à l’établissement le titre peu glorieux du cinquième pire zoo des USA.
Happy n’a donc depuis des décennies, connu rien d’autre que la captivité, la soumission aux hommes et la solitude. Si elle est « protégée » des dangers qu’elle aurait pu rencontrer dans son habitat naturel (utilisation pour les touristes, braconnage…), sa vie en captivité n’en est pas moins traumatisante.
Issus d’une société matriarcale, les éléphants d’Asie vivent en groupe d’une dizaine d’individus et passent une très grande partie de leur journée à rechercher de quoi se nourrir (un besoin d’environ cent kilos de branchages, fruits et feuilles). Ils marchent en moyenne une quinzaine de kilomètres sur un territoire pouvant s’étendre à 1500 km2.
De plus, tout comme les dauphins et les grands singes, les éléphants sont des animaux qui tissent des liens sociaux très forts entre eux, ils manifestent d’ailleurs à la perte de leurs proches des comportements comparables à un ceux exprimés lors d’un deuil chez les humains. Ainsi, Ils vont se recueillir sur le lieu du décès, couvrent le corps du défunt de feuillage ou encore caressent la dépouille de leur trompe (Karine Lou Matignon, Émotions animales, Éditions du chêne, 2005, p. 163).

Photo crédit : Pixabay
AU vu du non-respect des consignes de l’AZA (l’équivalente étasunienne de l’EAZA : Association Européenne des Zoos et Aquariums) qui stipulent notamment que les éléphants doivent être un minimum de trois dans un enclos, une pétition a d’ailleurs été lancée, demandant la libération de Happy et son placement dans un sanctuaire.
Malheureusement, Happy ne s’est pas vu reconnaître la personnalité juridique et n’a pas été jugée comme « illégalement emprisonnée » en décembre 2020 malgré son dossier. Pourtant elle aussi en 2005 avait réussi le test du miroir, un test associé à la reconnaissance de soi. Un grand miroir est placé devant l’animal sujet du test, quelques jours plus tard, une croix à la peinture est dessinée sur le front. Si l’animal se frotte l’endroit marqué lorsqu’il se regarde dans le miroir, c’est qu’il a conscience de son reflet. Jusqu’à présent, cet exercice n’avait été réussi que par des chimpanzés et des dauphins.
Les arguments des parcs zoologiques convainquent de moins en moins, faisant d’autant ressortir leur but commercial originaire. Car les zoos ne sont finalement pas grand-chose d’autre que des entreprises commerciales, maquillées de quelques bonnes intentions. Éthiquement, leur existence est difficilement justifiable de nos jours.
Steven Wise se bat dans le but de défaire le « statut et le traitement archaïque » des animaux qui sont considérés comme des « choses sans droits ».
Le projet revient ainsi sur l’un des fondements de toute société : liberté, autonomie, égalité et équité. Les autres animaux ne devraient pas être traités différemment des humains lorsque nos actions touchent à leur intégrité physique et psychologique. Ces droits sont fondés sur l’Habeas corpus, une notion juridique promouvant la liberté fondamentale de ne pas être enfermé sans jugement.
Ce n’est pas parce que les autres animaux et les hommes ne trouvent pas aujourd’hui le moyen d’échanger par un langage commun, que certains doivent se voir nier les droits les plus élémentaires. Chaque être vivant devrait avoir droit au respect de sa vie, et de ne pas la passer entre quatre murs pour le plaisir d’une espèce.

Photo crédit : Pixabay
La personnalité juridique a cependant été reconnue à Cécilia, un chimpanzé issu du zoo de Mendora en Argentine. Isolée depuis 2005, elle n’avait connu que la captivité et la négation de ses impératifs biologiques.
L’AFADA (Association de fonctionnaires et avocats du droit animal) a plaidé le cas de Cécilia, n’hésitant pas à la comparer à une esclave sur la base de l’Habeas corpus, réflexion introduite par Steven Wise. La juge Maria Alejandra Mauricio a accordé la personnalité juridique au chimpanzé et ordonné son transfert dans le sanctuaire de Sorocoba au Brésil réservé à son espèce.
Pour recevoir les demandes de l’AFADA, la juge appuie sa décision sur la protection collective du droit de l’environnement qui est un droit constitutionnel en Argentine, et qui peut déboucher sur l’octroi d’une protection individuelle.
La juge a bien expliqué qu’accorder cette personnalité juridique ne correspondait pas à avoir une vision anthropomorphique: « dans le cas présent, nous ne déclarons pas que les animaux êtres sensibles sont pareils aux êtres humains et nous n’élevons pas dans une catégorie humaine tous les animaux existants ou la faune et la flore ; nous reconnaissons et nous confirmons que les primates sont des personnes juridiques non humaines possédant des droits fondamentaux qui devraient être étudiés et énumérés par les autorités de l’État, tâche qui dépasse le cadre de notre compétence (…) et relever d’une législation en concordance avec ces droits pour les protéger dans la situation particulière où ils se trouvent et en fonction du degré d’évolution que la science a déterminé qu’ils peuvent atteindre. Il ne s’agit pas de leur accorder les mêmes droits qu’aux êtres humains ; il s’agit d’accepter et de comprendre une fois pour toutes qu’ils sont des êtres sensibles ayant une personnalité juridique avec des droits fondamentaux parmi lesquels ceux de naître, vivre, se développer et mourir dans un environnement adapté à leur espèce ».[1]
[1] https://www.ensemblepourlesanimaux.org/project/cecilia-le-premier-chimpanze-reconnu-personne-non-humaine-dotee-de-droits-fondamentaux/#

La personnalité juridique a également été accordée à Sandra, l’orang-outan sud-américaine reconnue par la justice argentine le 18 décembre 2014 comme un « sujet de droit ».
L’AFADA a porté ce combat plus loin encore. Via l’amparo (un mécanisme juridique en droit hispanophone permettant aux particuliers d’exercer une requête directe en contrôle de constitutionnalité), la juge Liberatori a reconnu Sandra comme « un sujet non humain ayant le droit à la liberté » par une décision du 21 octobre 2015.
L’orang-outan a, sur la décision du tribunal de Buenos Aires, été envoyé dans une réserve naturelle à Wauchula en Floride. Il a été jugé qu’elle pouvait bénéficier de la protection individuelle, la captivité lui ayant causé des dépressions chroniques.
Pour Paul Buompadre, avocat de l’AFADA « ceci ouvre la voie non seulement pour d’autres grands singes, mais aussi pour d’autres êtres doués de sens qui sont injustement et arbitrairement privés de liberté dans les zoos, cirques, parcs aquatiques et laboratoires scientifiques ».
Le droit doit-il servir les animaux ?
Si à cette interrogation, le « oui » semble l’emporter notamment grâce aux articles L214-1 du Code rural et de la pêche maritime (reconnaissance de l’animal comme un être sensible) et 521-1 du Code pénal (interdiction d’acte de cruauté), la question semble plutôt se poser de la sorte : le droit peut-il servir les animaux ?
Toujours considéré comme bien meuble en droit français, l’animal n’est aujourd’hui pas encore réellement respecté pour l’être vivant à part entière qu’il est et reste bien trop souvent reconnu uniquement comme propriété de l’homme.
Si les parlementaires français ont requalifié en 2014 les animaux comme des « êtres vivants doués de sensibilité » et non plus des « biens meubles » cette appellation reste dans les faits sans notables répercussions, il s’agit plutôt de ce qu’on pourrait appeler une fiction juridique langagière.
Bien que Darwin ait « restauré l’unité fondamentale du vivant »[1], sa désappropriation, c’est à dire le dénuer de toute forme de propriété, permettrait d’instaurer un statut juridique favorable aux animaux et ainsi, de les considérer comme des êtres vivants à part entière. Une personnalité juridique de l’animal pourrait en effet permettre une meilleure protection de ces individus réduits encore légalement aujourd’hui au statut d’animal-objet, au service de l’homme et en fonction de ce qu’il peut lui apporter, qu’il soit utilisé pour la consommation, le divertissement, la recherche ou la compagnie…ce sont des êtres vivants dont on nie bien souvent les besoins et les envies pourvu qu’ils remplissent le rôle qu’on leur a attribué.
[1] Amicus Radio, Fabien Marchadier, « Les statuts juridiques de l’animal » (1/5)

Photo crédit : Pixabay
Mais ne nous y trompons pas, l’attribution de la personnalité juridique ne signifie pas nécessairement que l’animal doit être titulaire de droits. La société ayant été créée autour et pour l’homme, il serait absurde d’exiger des animaux qu’ils vivent comme nous. Mais le fait qu’ils ne soient pas titulaires de droits ou d’obligations ne doit pas les contraindre à être emprisonnés à perpétuité.
Dans le passé, les hommes ont accordé des devoirs à des animaux tout en les préservant d’une jouissance de droit. Ainsi, des procès d’animaux se sont tenus au Moyen-Âge : cochons, truies, vaches ont été pendus ou brûlés au bûcher selon la sentence, aux États-Unis, l’éléphante Mary fut pendue par une grue le 13 septembre 1916 pour s’être rebellée contre son dresseur qui l’assenait de coups, car elle n’exécutait pas assez bien son tour.
Pour les êtres humains, la personnalité juridique est octroyée automatiquement à la naissance de l’individu. Elle est à distinguer de la capacité juridique c’est-à-dire de l’aptitude à exercer/jouir de prérogatives juridiques. Il existe des incapacités de jouissance qui représentent le plus souvent des peines comme l’interdiction de droits civiques, et d’exercice définit par l’article 1124 du Code civil comme les mineurs ou les majeurs protégés. Ainsi il existe en droit français une personnalité juridique où les droits fondamentaux accordés par nature aux hommes ne supposent pas l’exercice de prérogatives.

Photo crédit : Pixabay
Jeremy Bentham, philosophe et juriste britannique déclarait à ce titre « La question n’est pas : Peuvent-ils raisonner ? ni Peuvent-ils parler, mais : Peuvent-ils souffrir ? »
Les animaux ne doivent pas attendre que nous les trouvions assez intelligents pour les considérer comme des titulaires de droit. Si certains ont passé le test du miroir et pu prouver ainsi qu’ils reconnaissaient leur propre corps, la notion subjective d’intelligence humaine ne devrait pas être un obstacle pour accepter que tout être vivant possède des besoins biologiques et le droit à leur respect. Pour Frans de Waal, primatologue « En biologie, on ne place pas l’humain au-dessus des animaux » (FranceInter, L’invité de 8h20, émission du 4 octobre 2016) alors pourquoi ne pas étendre ce principe à la sphère juridique ?
Pour Jean-Baptiste Jeangène Vilmer « L’homme n’est pas le seul animal à penser, mais est le seul à penser qu’il n’est pas un animal ».[1] Ainsi, si globalement nous ne tolérons pas les injustices et souffrances perpétrées aux hommes, pourquoi accepter celles qui sont infligées tous les jours aux autres animaux ?
On oublie consciencieusement une réalité scientifique, aidé pour cela par les mots et le langage utilisés au quotidien, mais les humains sont par nature des animaux !
A ce titre, Tom Regan dénonce le « modérantisme » de l’homme face aux mesures qui sont prises pour ces personnes « non-humaines », mesures qui ne visent bien souvent que l’amélioration de leur bien-être. De fait, nous nous fourvoyons avec des lois nouvelles, des expressions juridiques nouvelles et des consignes nouvelles pour un maigre résultat. Il ne peut y avoir de réelles avancées en éthique animale si les mesures qui sont prises sont insubstantielles. Le but ne devrait pas être d’améliorer les conditions de vie des animaux sauvages captifs mais de proscrire leur captivité.
[1] Jean-Baptiste Jeangène VILMER, Éthique animale, PUF, 2008

Photo crédit : Pixabay
Pour reprendre l’exemple de l’éléphant, un enclos plus grand ne rendra pas fondamentalement Happy plus « heureuse » ni même la compagnie d’un autre éléphant ou la présence d’un étang. L’éléphant est un animal grégaire et nomade, qui a besoin de beaucoup d’eau, pour se désaltérer bien sûr, mais aussi pour renforcer ses liens sociaux avec ses congénères au cours des baignades. Le territoire d’un éléphant peut aller jusqu’à 1500 km2, il peut marcher jusqu’à 20 km/jour. En captivité, il développe souvent ce qu’on appelle des stéréotypies vidéo de stéréotypie , vidéo d’un éléphant de zoo en stéréotypie ,c’est à dire des mouvements de va-et-vient, dénués de sens et qui révèlent un profond mal-être[1], signe d’un échec d’adaptation à un habitat qui n’est pas le leur[2]. Le zoologue Fred Kurt associe ces mouvements stéréotypiques à la folie humaine.
Dans l’hypothèse où un parc zoologique parviendrait à gommer les problèmes les plus flagrants liés à la captivité, il n’en resterait pas moins une question éthique fondamentale concernant la privation de liberté d’un individu pour un crime qu’il n’a pas commis.
La solution à la disparition des espèces causée par :la destruction des habitats, l’urbanisation galopante, la déforestation, le changement climatique (principalement dû à nos activités humaines) , le braconnage (causé aussi par la paupérisation des populations locales et les inégalités ), le trafic international…serait de maintenir enfermés tous ces animaux pour qu’ils soient présentés au public ?
Outre le fait que la majorité des espèces présentées dans les zoos ne sont pas classées « En danger » sur la liste rouge de l’IUCN, il ne faut pas réfléchir longtemps pour comprendre que cette solution est dénuée de sens. Les zoos sont des entreprises commerciales qui après avoir pillé la nature sans restriction jusqu’à la signature de la convention de Washington en 1973, continue à le faire allègrement pour certaines espèces qu’ils font capturer directement dans leur milieu naturel.
Sous couvert de justificatifs éducatifs, conservationnistes ou de recherche, des animaux se retrouvent exhibés devant un public qui pourtant bien souvent ne voit dans le zoo que l’occasion de faire une sortie en famille.
[1] HANNIER I., in le point vétérinaire vol.26 n°165, février 1995
[2] BRIDE Mc, GLEN & CRAIG, J.V., « Environmental design and its evaluation for intensively housed animals» in Bresard B., 1985

Photo crédit : Pixabay
La captivité des animaux sauvages a aujourd’hui été tristement banalisée, par le biais d’activité comme les « soigneurs d’un jour » ou la possibilité de loger au milieu d’une espèce dans les zoos, les spectacles au sein des parcs comme c’est souvent le cas des cétacés, et plus récemment par des émissions télévisées ou reportages mettant en avant les espèces sauvages comme des objets de divertissement ou d’animaux de compagnie (Saisons au Zoo diffusé sur France 4, Les mordus des NACs diffusé sur TF1).
Les parcs zoologiques vendent aujourd’hui la proximité avec des êtres sauvages, violant ainsi leur intimité et leur imposant des activités qui n’auraient lieu d’être à l’état naturel sur le postulat de l’amour de la nature ou la préservation des espèces. Il n’y a pas de place pour le respect de ces animaux qui sont contraints à vivre dans un environnement qui n’est pas le leur et à suivre un emploi du temps qui profitent aux investisseurs. Il ne peut y avoir de bonnes intentions lorsque l’on nie ses droits les plus primaires à un être vivant dans une logique financière.
De plus, quand bien même les animaux passent le test du miroir, que le résultat soit positif ou négatif, il n’est pas source de droit. En se basant sur ce genre de tests, l’homme souhaite confirmer sa singularité, car il n’évalue pas l’intelligence animale sur un terrain neutre, mais sur un test qu’il a lui-même créé. Ces tests ont été réussis par les chimpanzés et les dauphins, mais ces espèces sont toujours captives, enfermées dans des enclos et loin de jouir d’une personnalité juridique et donc de droit.
Donald Griffin, zoologiste américain inventa le concept de mentaphobie pour nommer « la réticence de ses pairs à faire référence à la conscience animale lorsqu’il s’agit de décrire le comportement des animaux. »[1] Ce terme fut repris par David Chauvet, docteur en droit français, qui le définit comme « la peur de reconnaître la pensée de celui dont on ne veut pas qu’il devienne « autrui », et qu’on veut assimilable à une chose. »[2]
La personnalité juridique octroyée aux animaux sauvages permettrait la fermeture des lieux d’emprisonnement, la reconnaissance des structures accueillant ces individus, des peines plus lourdes pour les vendeurs de faune sauvage mais également une meilleure protection de l’habitat naturel afin de préserver pleinement leurs droits.
[1] Donald Griffin, Animal Minds: Beyond Cognition to Consciousness, University of Chicago Press, 1992, revu et réédité en 2001.
[2] David Chauvet, « Abolitionnisme, welfarisme et mentaphobie »

Photo crédit : Pixabay
Il est urgent que la personnalité juridique soit accordée à ces « personnes non humaines », car sans norme législative, aucune conséquence ne pèse sur ceux qui nient à d’autres des besoins biologiques primaires. L’histoire parle d’elle-même pour pointer cette nécessité d’une législation, car sans droit, il n’existe pas de notion de juste ou d’injuste et l’homme reste seul à décider de ce qui est bon ou mauvais, selon ses intérêts et n’ayant faire de l’éthique, n’obéissant qu’à la contrainte.
L’environnement est un thème clef du XXIème siècle. La reconnaissance du crime d’écocide pourra sans nul doute apporter son soutien à la cause animale, car il constitue « un crime délibéré contre la sûreté de la planète, qui menace les conditions d’existence de ses habitants présents et futurs ». Permettant ainsi aux plus réfractaires d’accepter que les animaux ne soient pas sur terre pour nous servir et qu’ils disposent, au même titre que les hommes, d’un droit à l’intégrité physique ne permettant pas l’enfermement.
Pénélope Ehles

Photo crédit : Pixabay
Aller plus loin
Zoo-de-France.com : le site de Code Animal pour dénoncer la captivité dans les zoos.
ElephantHaven : le premier sanctuaire pour éléphant en France et en Europe, afin de « créer un havre de paix » aux victimes de la captivité.
- Nonhuman Rights Project
- Podcast Radio Amicus Curiae : Les statuts juridiques de l’animal
- Colloque de la LFDA : Droits et personnalité juridique de l’animal
- Revue semestrielle de droit animalier
Sources
- https://radio.amicus-curiae.net/podcast/les-statuts-juridiques-de-lanimal-par-fabien-marchadier-1-5/
- https://www.nytimes.com/2015/06/28/nyregion/the-bronx-zoos-loneliest-elephant.html
- http://www.zoo-de-france.com/content/sandra-la-premi-re-personne-non-humaine-enfin-libre
- https://www.maxisciences.com/orang-outan/sandra-l-orang-outan-qui-a-obtenu-son-droit-de-vivre-en-liberte-dans-un-tribunal_art34046.html
- http://www.savoirs.essonne.fr/thematiques/la-vie/biologie-genetique/hommeanimal-les-frontieres-sestompent/
- https://gothamist.com/news/judge-rules-bronx-zoos-happy-elephant-not-unlawfully-imprisoned
- http://www.revue-klesis.org/pdf/animalite07Chauvet.pdf
- https://www.delitfrancais.com/2019/01/29/tom-regan-et-les-droits-des-animaux/
- https://uk.news.yahoo.com/happy-elephant-denied-rights-designed-141741776.html?guccounter=1
- https://www.ensemblepourlesanimaux.org/project/cecilia-le-premier-chimpanze-reconnu-personne-non-humaine-dotee-de-droits-fondamentaux/#
- https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/01/27/steven-wise-l-avocat-des-grands-singes_5248092_3232.html
- https://www.geo.fr/histoire/erwin-la-ville-qui-a-pendu-un-elephant-le-13-septembre-1916-197475