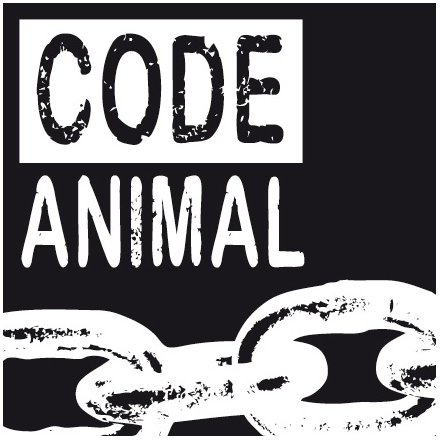Si l’on tentait de définir le parcours de l’animal de boucherie en respectant la chronologie naissance, élevage, transport, abattage, puis transformation en carcasse, on irait à contresens de la logique du système actuel. On ne part plus aujourd’hui de l’animal pour aller vers la viande, comme pourrait le laisser sous-entendre une telle chronologie, mais, bien au contraire, de la viande pour remonter vers l’animal. C’est la viande consommée (sa qualité, sa quantité, son prix, etc.) qui définit et donc conditionne l’existence même de la bête.
 À la question « A quoi sert un cochon ? », une publication jeunesse répond : « A faire de la charcuterie ! » Cette question-réponse est significative du lien qui a progressivement été rompu entre le consommateur et la nature. L’existence intrinsèque de l’animal n’aurait pas de raison d’être, le cochon n’existerait pas pour lui-même ; sa vie n’aurait de sens que par rapport à ce qu’il est en mesure de produire pour les hommes, à tel point que le morceau de viande dont il est le devenir semble être davantage considéré que l’animal lui-même
À la question « A quoi sert un cochon ? », une publication jeunesse répond : « A faire de la charcuterie ! » Cette question-réponse est significative du lien qui a progressivement été rompu entre le consommateur et la nature. L’existence intrinsèque de l’animal n’aurait pas de raison d’être, le cochon n’existerait pas pour lui-même ; sa vie n’aurait de sens que par rapport à ce qu’il est en mesure de produire pour les hommes, à tel point que le morceau de viande dont il est le devenir semble être davantage considéré que l’animal lui-même
En effet, dès sa naissance, l’animal doit répondre à des impératifs productivistes ; il doit ingurgiter des antibiotiques, grossir, produire de la chair ; la viande, quant à elle, sera émincée, cuisinée, décorée avec délicatesse, le tout à destination de l’assiette du consommateur. Et l’attention portée à cette assiette est telle qu’il est légitime de se demander si l’amour du cuisinier face à sa bavette de veau n’est pas plus fort que l’amour de l’éleveur pour ce même animal ?
Davantage de respect pour le mort que pour le vivant
Dans les élevages, on compte les poules, les poulettes, les lapins par unité de mille têtes et la mortalité en pourcentage ; le cuisinier, quant à lui, se concentre sur sa cuisse de lapin individuelle avec infiniment plus d’attention et de respect qu’il n’en avait lorsque ce même lapin était enfermé dans un lot de mille têtes. En d’autres termes, plus on se rapproche du bout de la chaîne, c’est-à-dire de l’assiette du consommateur, plus le respect pour l’animal semble devenir grand, alors pourtant que l’on va du vivant vers le mort.
C’est donc à une réification de l’animal que le système consumériste actuel conduit et ce, dans une indifférence quasi générale.
La réification de l’animal apparaît à tous les niveaux.
- Sélections génétiques et expérimentations sur les animaux (poulet rouge pelé sans plume par exemple).
- Insémination artificielle et utilisation de verrats robots afin de stimuler les chaleurs.
- Maturation artificielle des oeufs dans les couvoirs et naissance par milliers de poussins sans la présence de leur mère (qui de son côté continue à produire, si elle n’a pas déjà été abattue).
- Destruction par broyage, étouffage ou gazage des poussins inutiles. Ainsi faute de pouvoir devenir des poules pondeuses, plus de 50 millions de poussins mâles (éveillés) sont exterminés par an en France.
- Homologation de l’animal dès son entrée dans le circuit ; il devient « animal d’élevage », « animal de batterie » ou « animal de consommation », comme s’il était par essence né pour cette fonction. A cet égard, on devrait, en toute logique, parler d’animaux « dans les élevages » ou d’animaux « enfermés dans des batteries ».
- Numérotation des porcs, des vaches qui perdent leurs prénoms (la fameuse Marguerite) pour se fondre dans une identification informatique. Renforcé par la traçabilité, le code barre de la barquette de viande se confond presque avec le numéro tatoué sur l’animal ; absence de prise en compte des besoins physiologiques de ces animaux :
- le cochon est pourvu d’un groin qui lui permet de fouiller, retourner la terre ; ce groin ne lui sert plus à rien en élevage industriel ;
- les cochons, les veaux, les poules pondeuses ou les lapins ont des pattes qui en toute logique sont faites pour marcher ; ces animaux sont condamnés à l’immobilité dans des cages, des cagettes ou des stalles ;
- les poules ont un bec pour picorer dans la terre ; les becs sont coupés à vif (le débecquage) afin d’éviter que ces animaux entassés et donc stressés ne se piquent et ne se déchirent entre eux ;
- les plumes des canards sont adaptées à une vie semi-aquatique ; les mares sont inexistantes dans les hangars ;
- ces animaux vivent dans un groupe social structuré ; en élevage industriel, ils sont parqués et entassés les uns contre les autres ;
- le lait de la vache est fait pour nourrir un veau ; celui-ci est ôté à sa mère avant qu’il ne commence à téter afin d’éviter que la vache contrôle et régule sa descente de lait ;
- enfin et surtout l’animal naît pour vivre.
Faits pour être mangés
A ce titre, s’atteler à la recherche de l’espérance de vie des animaux enfermés dans un élevage relève de la gageure. En effet, lorsque l’on cherche à connaître les chiffres, deux objections sont immanquablement soulevées :
- d’abord,ce calcul serait stupide car ces animaux ne sont pas faits pour vivre et, en tout état de cause, si on les laissait vivre, ils ne pourraient pas vivre naturellement dans la mesure où ils ne sont pas faits pour cela (dixit) !
- Ensuite, personne ne connaît précisément la réponse car, à dire vrai, cela n’intéresse personne, l’animal, une fois de plus, n’étant pas fait pour vivre, mais uniquement pour être mangé.
Ces objections dépassées, tristes reflets de cette réification de l’animal, on peut, grâce à quelques personnes qui ont eu « l’idée » de laisser vivre un cochon ou un poulet sans vouloir à tout prix le consommer, dresser le tableau comparatif suivant.
| Animaux | Espérance de vie | Age moyen d’abattage en élevage |
| Veaux, vaches | 20 ans | Le veau est abattu à 3 mois – La vache laitière, épuisée par la production de 12.000 kg de lait/an), est réformée à moins de 6 ans. |
| Poulet de chair | 7 ans | Abattu à 6 semaines. |
| Cochon | 20 ans | Abattu à 5 mois et demi. |
Le nombre de ces jeunes animaux abattus en France (Chiffres Agreste – 2003) est édifiant.
| Canards | 73,9 millions |
| Dindes | 95,7 M |
| Pintades | 29,2 M |
| Oies | 710 000 |
| Gallus (poules, coqs…) | 779 M |
| + 50M de poussins abattus dès la naissance | |
| TOTAL VOLAILLE | + d’1 milliard |
| Lapins | 40 M |
| Bovins | 5,6 M dont 2 M de veaux |
| Ovins et caprins | 7,4 M |
| Porcins | 26 M |
| Équidés | 31 000 |
À ceci s’ajoutent les espèces non comptabilisées (autruches, bisons, grenouilles, escargots…), les animaux chassés (légalement et illégalement), les animaux morts dans les élevages ou lors du transport (+ 4% de mortalité en moyenne), les animaux détruits pour cause de fièvre aphteuse, de peste porcine, de peste aviaire ou de vache folle, ainsi que les poissons et crustacés (que l’on ne compte même plus par lot de mille têtes mais par tonnes), sans compter les « rebuts » dérivants de ces activités. On peut ainsi raisonnablement estimer qu’au minimum 3 milliards d’animaux sont tués directement et indirectement chaque année en France pour notre consommation (hors import/export).
À cette hécatombe, s’ajoute une disparition progressive d’espèces d’animaux domestiques (la poule hergnie, la vache vosgienne, le porc noir gascon…) due à la standardisation des animaux sélectionnés pour leurs performances en production (poules Isabrown, porcs Large White…).
L’opacité, condition de fonctionnement du système
Cette production intensive conduit à des élevages-usines dont sont issus plus des 2/3 des cochons et volailles. Les porcs passent leurs quelques mois d’existence dans le noir, immobiles sur des sols en caillebotis ; les poules sont entassées sans possibilité de se mouvoir ni d’étendre leurs ailes. Tout est optimisé afin de produire un maximum en un minimum de temps et d’effort. Et les animaux en sont les victimes silencieuses ; leurs vies sont sacrifiées, effacées pour répondre à la demande consumériste. Pour reprendre la lucide observation de Jocelyne Porcher, « les animaux en systèmes industriels, du point de vue du système, ne meurent pas, ils sont déjà morts (1) ».
Un tel système ne peut survivre que par son opacité. Il est important que le consommateur ne puisse pas établir de lien entre son assiette et ces lieux de production, aussi traditionnels soient-ils, dans lesquels l’animal n’est rien d’autre qu’un produit de consommation en devenir.
L’éducation de l’enfant puis l’information délivrée à l’adulte sont orientées afin que rien ne transparaisse. Ainsi faut-il à tout prix rompre le lien que l’enfant pourrait établir entre son lapin en peluche ou son petit cochon rose-tirelire et le civet ou le jambon que ses parents lui feront manger. D’ailleurs, la dénomination n’est plus la même (lapin, cochon vs civet, jambon).
Une mystification bucolique
Nombres d’histoires enfantines évoquent des animaux. Dans les « 3 petits cochons », les cochons parlent, ont des émotions. L’enfant s’émeut face à ces trois pauvres petits compagnons que le méchant loup veut manger. Et pourtant, c’est ce même enfant qui, comme chacun de nous, va, sans le savoir, devenir le grand méchant loup en consommant sa purée au jambon. Notre cruauté est attribuée au prédateur à exterminer, transposée sur lui, victime expiatoire, comme pour mieux esquiver notre propre responsabilité et nous permettre ainsi de continuer à consommer sans nous interroger. De manière générale, les fermes pédagogiques et les livres d’enfants présentent des animaux volontairement placés hors du contexte actuel des élevages. Cette mystification bucolique tend à donner une image idyllique de l’animal dans une ferme. Pourtant le véritable pédagogue devrait présenter l’animal dans un élevage industriel afin de permettre à l’enfant, adulte en devenir, de tisser le lien entre le poussin broyé ou le veau abattu et la viande qu’il consomme.
Par ailleurs, les animaux destinés à la consommation sont affublés de termes péjoratifs : « les poules sont bêtes », « les porcs sont sales », notamment. Cette dévalorisation et ce mépris de l’animal permettent de déculpabiliser comme de désinformer un peu plus le consommateur. À cet égard, les reportages télévisuels ne s’attardent que trop rarement sur les conditions de vie des animaux en élevages industriels. Si des associations de défense animale n’avaient pas fait des investigations, qui s’en serait soucié ?
Anesthésier les inquiétudes
Ainsi, les élevages sont-ils devenus des bunkers dont on ne peut percevoir que les contours ; les abattoirs ont-ils été reculés aux périphéries des villes et loin des lieux de vente. Comme le souligne Florence Burgat « celui qui tue n’est plus celui qui vend »(2). Les cadavres ont disparu pour laisser la place aux carcasses qui à leur tour ont été reléguées dans des chambres réfrigérées et closes. Les devantures des magasins ne présentent plus que de la viande en morceaux conditionnés, aseptisés, cuisinés aux formes géométriques. Quant à la publicité, complice active du système, elle ne montrera jamais les élevages ou l’abattage, mais axe de plus en plus ses annonces sur cet « amour de la viande » et sur des animaux très guillerets qui font eux-mêmes l’apologie de leur propre chair !
Toutefois, si une partie de la population s’interroge sur les conditions d’existence imposées à l’animal et s’apitoie sur ses souffrances, le système doit impérativement anesthésier les inquiétudes du consommateur et, le déculpabiliser ainsi de se nourrir de vies animales. Pour cela, le Bureau de la Protection Animale veille, tout étant sous l’étroit contrôle de spécialistes. Comme son nom ne l’indique pas, ce bureau, représenté sur le terrain par les Directions Départementales des Services Vétérinaires, dépend directement du Ministère de l’Agriculture. Concrètement, il en résulte que la protection de l’animal est liée à sa destination, c’est-à-dire à sa mort ! Autant dire que l’animal n’a en lui-même aucune existence et que cela ne dérange personne.
L’alibi du bien-être
Mais, l’anesthésique absolu est récent et se nomme « bien-être animal ». Ce concept est venu ces dernières années, tel un label de bonne conduite, rassurer le consommateur. De nouvelles normes sur les transports ou sur la superficie consentie à l’animal en batterie ont été programmées afin d’améliorer en apparence, le « bien-être de l’animal », ce dans quelques années seulement. Mais enfin, peut-on décemment parler de « bien-être » dès lors que l’animal reste enfermé dans un bunker et qu’il est abattu dès l’enfance ? Avant de vouloir « bien-être », nul ne peut nier que l’animal souhaiterait tout simplement … être, c’est-à-dire pouvoir gratter, picorer, courir, se reproduire, farfouiller, jouer. Est-ce trop idéaliste de penser que le veau voudrait pouvoir téter sa mère plutôt que de lui être arraché et qu’il voudrait tout simplement vivre, voire ne pas mourir tout de suite ?
En tout état de cause, même lorsque le consommateur sait, il ferme les yeux par indifférence ou par faiblesse ; les coupables sont toujours ailleurs. D’un bout à l’autre de la chaîne, l’homme accuse le système alors pourtant qu’il accepte d’être l’un de ses rouages, lui permettant ainsi de fonctionner et de broyer chaque année des millions de vies. L’homme se trouve des excuses, des justifications, des alibis ; il se fond dans la masse silencieuse à la source de laquelle il alimente sa faiblesse et devient ainsi complice d’un système qu’il n’ose combattre. Et pourtant il suffirait, pour mettre fin à cette oppression, à cette réification de l’animal, que l’homme accepte, simplement, de laisser remonter en lui ce sentiment de compassion trop longtemps oublié .
Franck Schrafstetter, décembre 2004
(1) Jocelyne Porcher, La mort n’est pas notre métier, Editions de l’aube, 2003
(2) Florence Burgat, L’animal dans les pratiques de consommation, PUF, 1995
La reproduction du texte de cette page est autorisée, sous réserve de citer la source et les auteurs.